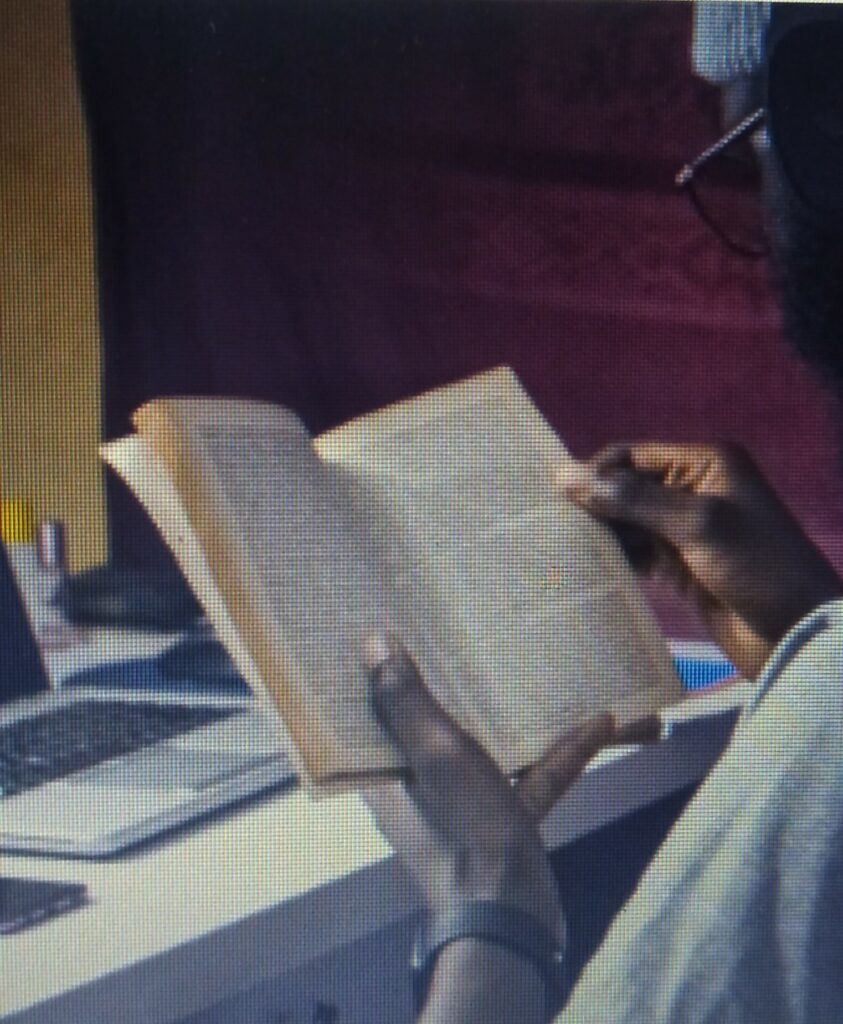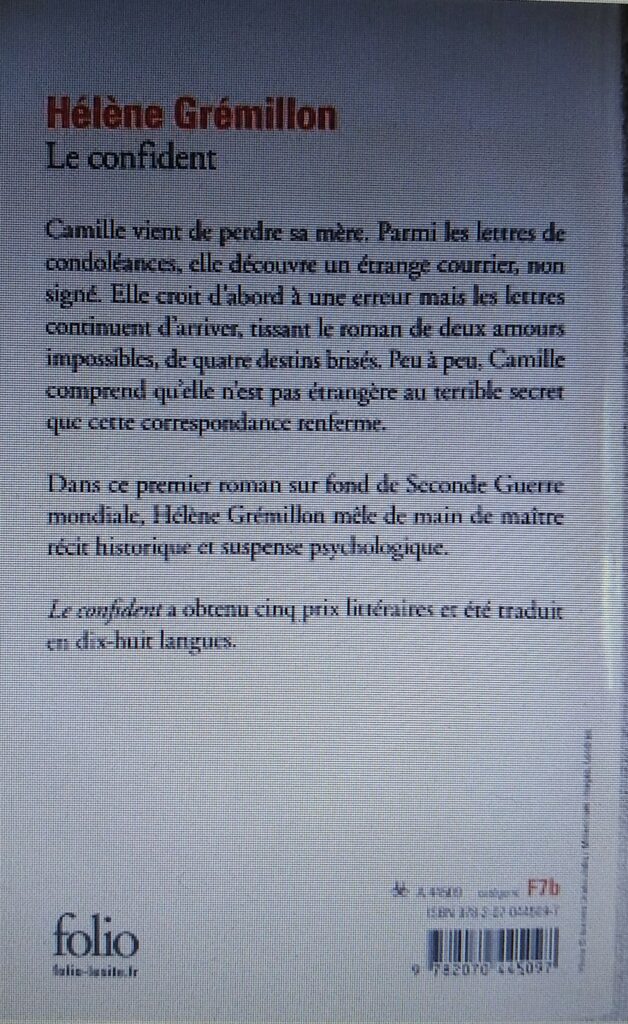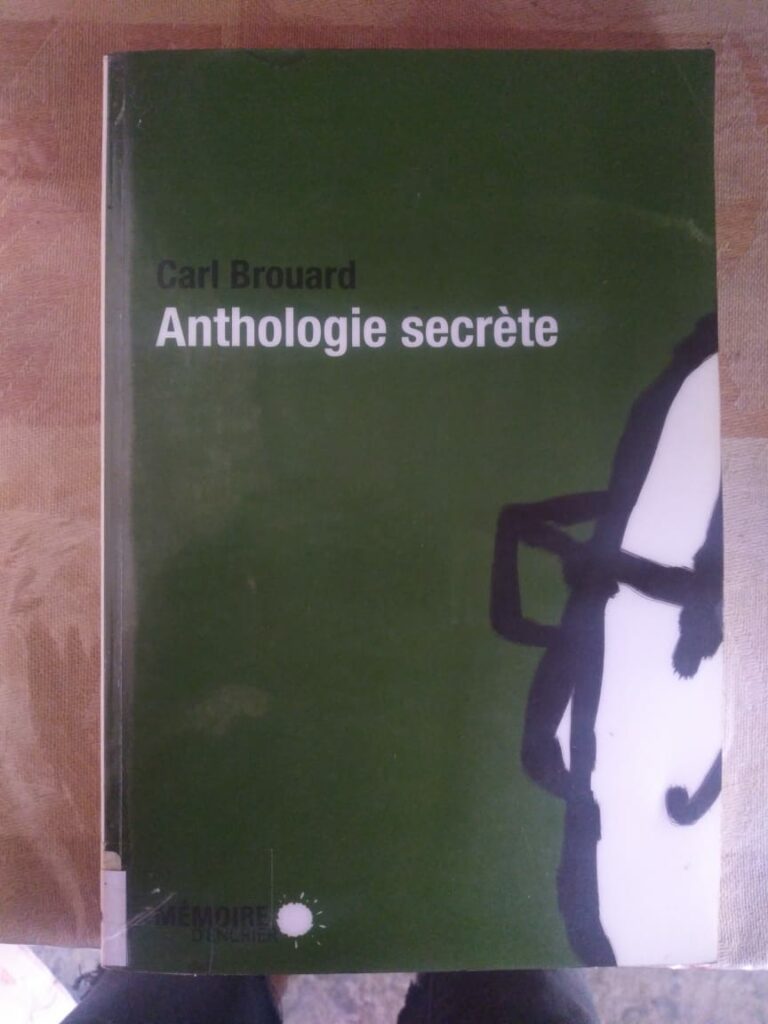Portrait d’un instant
“Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s’il meurt ; et quiconque vit en croyant en moi ne mourra jamais. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s’il meurt ; et quiconque vit en croyant en moi ne mourra jamais”.
Je n’ai jamais aimé cet homme. Il habite tout près de chez moi. Je ne me souviens pas l’avoir parlé un jour. Lui non plus, je suppose. Pourtant, le voir ce matin, suffoquant et récitant son verset à la rue Ti boule m’a donné un élan de compassion.
Personne sur le chemin pour m’aider. J’ai appris comment faire pour donner les premiers soins à quelqu’un. Je me penche sur ce corps avec une vie qui fait ses adieux à la terre.
“Tiens bon. Je vais te sortir de là.
“Mon heure est venue. Il est temps que je parte. Ne me trouble pas mon ami. Ne m’empêche pas d’aller vers ma félicité.
Et, faisant son chemin vers sa félicité, il récite. Chapitre ceci, verset cela. Il part et ne veut pas rester.
Ses yeux se penchent. Ce regard fragile, sans inquiétude, qui dit en silence. Le tout dernier.
C’est impossible qu’un regard ramasse tout le monde. Que le monde se penche pour en ramasser un, peut-être. Et pourtant, ce regard semble ramasser plus qu’un monde. Alors c’est à ça que ressemble un dernier regard ? Avant que les yeux se ferment une dernière fois ? Avant que le monde parte ? Qu’est-ce qu’on voit une dernière fois ? Sa vie ? Est-ce qu’une vie est assez courte pour défiler dans un regard ? Ou bien est ce qu’un regard est assez long pour mesurer une vie ? Le passé est toujours vieux. Très vieux. Peut-être trop vieux pour braquer un regard et y rester le temps d’un instant. Parce que vivre c’est passer. Vivre c’est ne plus rester. Vivre c’est s’en aller un peu chaque jour. Peut-être que c’est la seule chose à laquelle on pense au dernier moment. Peut-être que c’est la seule chose qui ose circuler dans un dernier regard. Serait-il assez grand pour s’approprier un dernier coup d’œil ?
La vie. Quelle stupidité. On est bien, tranquille à ne pas exister, et un bon matin, deux personnes décident, ou mieux, elles sont convaincues à notre place qu’on serait mieux en vie. Et un jour, nous voilà à repasser une vie, la nôtre. Cette vie qu’on n’a pas décidé d’avoir, voilà qu’on est forcé de la regarder se faufiler à l’intérieur de quelques secondes, se défiler pendant un instant et se perdre. Et là, on se souvient. On se souvient des soleils qui n’ont pas su rester. Des lunes qui sont mortes trop tôt. Des visages qui, un jour, nous ont croisés sur la route, avec nos bottes pleines de poussière et qu’on a vite oubliés. Des clins d’œil qu’on n’a pas rendus. Des sourires qu’on n’a même pas remarqués. Combien de personnes on croise par hasard dans une vie ? Combien sont encore en vie ? Combien le seront après nous ? Combien d’inconnus auraient pu être la meilleure chose qui nous soit arrivée dans la vie ? Combien de gens auraient pu vouloir être là, en ce moment où le dernier regard n’a plus pour longtemps ? Et on se souvient de la plus belle histoire qu’on a vécue. La première drague. Le premier baiser. Avec qui on a fait l’amour pour la première fois. Avec qui on a fait l’amour pour la dernière fois. Les plus belles histoires de notre vie. Celles qui font dire “je ne suis pas mort, j’ai vécu”. Les plus belles histoires sont souvent des histoires d’amour. Une histoire de haine ne peut pas être la plus belle histoire d’une vie dixit ma mère. Ah celle-la, toujours à aimer plus que de raison. Et on se souvient du plus beau jour de notre vie. Pour ma mère, le plus beau jour d’une vie c’est le jour où on a accepté Jésus comme notre sauveur. Et on y a cru de toutes nos forces. Parce qu’on a besoin de croire en quelqu’un ou en quelque chose qui est plus grand que nous. Ou bien qui a moins de limites que nous. Comme cette petite qui avait trois ans peut-être ce matin de rentrée de classe que cette dame tenait par le bras. Elle ne s’est pas préoccupée. Cette main qui la tenait était plus grande que la sienne. Et elle a cru. Et elle s’en est foutue. On a tous cet enfant de trois ans quelque part en nous. Et on croit. Et on s’en fout. Parce que croire c’est s’en foutre. Et on se souvient des erreurs qu’on a faites. Et des regrets on en a à revendre.
Pourquoi veulent-ils tous être des gens bien au moment de mourir ? Avoir une dernière parole à dire ? Un dernier truc à avouer ? Ils avaient toute une vie pour dire. Ils avaient toute une vie pour aimer. Pour prendre d’assaut le hoquet des jours. Pour aimer le sourire des choublak. Pour suturer les nuits blessées et faire de l’aube une fête qui n’a pas trouvé nom à sa pointure. Ils avaient toute une vie pour ne pas tout foutre en l’air. Ils avaient toute une vie pour regretter, ou pour ne pas regretter. Vivre, c’est retarder l’échéance. Vivre, c’est mourir à voix basse. Oublier cette partie de la saga, c’est faire le con trois fois de suite, et recommencer.
Cet homme n’a rien dit. Seulement son verset. Peut-être qu’il a tout dit dans ce regard. Il a peut-être tout dit de son vivant. Ah ! Il n’est pas encore mort. Peut-être qu’il n’y a rien à ajouter. Il n’est pas comme ces écrivains qui ont toujours un dernier mot. Une dernière phrase à ajouter au récit. L’œuvre n’est jamais parfaite. Jamais finie. Je déteste ces écrivains. À quoi bon alors puisque ce récit n’atteindra jamais la perfection ? Peut-être qu’il avait tout compris lui ?
“Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s’il meurt ; et quiconque vit en croyant en moi ne mourra jamais. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s’il meurt ; et quiconque vit en croyant en moi ne mourra jamais.
Je n’ai jamais su comment il s’appelait. Maintenant, il meurt à côté de moi. Anonyme. Comme moi. Comme nous tous. Ne sommes-nous pas tous des inconnus ? Des anonymes ?
Tout homme debout n’est qu’un souffle. Un verset, je crois. J’ai l’impression d’avoir une brise à côté de moi. Une brise qui s’éteint. Je ne vais pas aller faire du sport aujourd’hui. Aujourd’hui, je regarde un homme mourir, accepter le cadeau que lui fait le ciel. Peut-être que je ne vais pas y aller du tout après aujourd’hui.
“Je suis la ré sur rec tion et la vie . Cel…”
Et puis rien. Après avoir détaché les syllabes dans la première phrase de ce verset, je crois que c’est un verset, et commencé la phrase qui vient juste après, silence. Ses yeux se ferment petit à petit. Avant de les fermer complètement, sourire bête. Peut-être qu’il a vu comme l’autre en encaissant les coups de pierre. Jésus à la droite de son père. Actes des disciples etcetera etcetera. Il souriait rarement de son vivant.
Je ne connais pas le nom de cet homme qui est mort ce matin. Qui a tout passé en revue dans un regard. Connaître son nom, c’est la moindre des choses. Mais à quoi bon maintenant ? Que sert-il à un mort d’avoir un nom ?